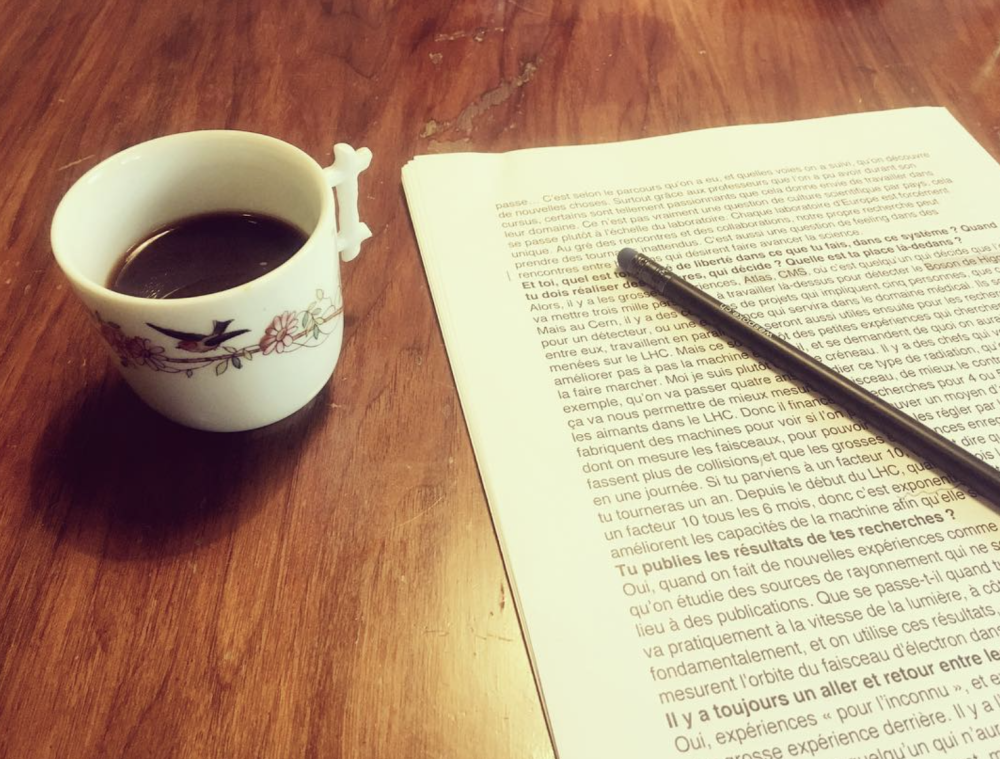Journal libre
Ici, au gré du vent et des envies, un format libre qui révèle quelques textes en partage
Carnets de route - Espagne 2025
Granada
Je rêvais de visiter l'Alhambra, son grand mystère encapsulait des rêves de gosses, comme savent le faire ces lieux qui nous intiment à dire "une fois, j'irai".
Comme ce voyage espagnol avait largement été improvisé, j'avais pris mes billets 2 semaines en avance, étonnée de voir qu'il n'en restait déjà presque plus, ce qui m'obligeait à traîner plus que souhaité dans la région de Grenade. Mais la vie faisant souvent bien les choses, c'est aussi cette latence qui m'a permis de découvrir les communautés soufies autour d'Orgivá et d'y passer deux petits jours magnifique en pleine nature et retraite musicale.
Le 31 donc, mon billet stipulait 9h. Il fallait être pile, m'avait-on prévenue. Ç'avait été tout un bazar de trouver où garer le van pour ne pas me lever aux aurores (Grenade canalise attentivement son tourisme pour ne pas être totalement noyée), et j'étais parvenue, totalement excitée, à être dans les temps et la longue file devant le Palais des Nasrides, coeur-joyau de l'Alhambra.
Arrivée au portique électronique, biiiip, "non désolée, ce n'est pas le bon billet, avec celui-là, vous n'avez accès qu'aux jardins et aux musées".
A cet instant précis, un truc profond s'est passé en moi. Comme une rage, qui m'a instantanément fait pleurer comme une petite fille. J'ai tenté de reprendre mes esprits avec un café et un mauvais croissant (je deviens parisienne), avant de faire le tour des guides et différents vigiles pour tenter de trouver une solution.
Nada, no sé, disculpe.
Je suis restée là longuement, à voir le flux de touristes défiler, à canaliser une grande frustration vraiment, que d'être juste là, mais empêchée. C'était un peu comme être à Agra et de ne pas pouvoir voir le Taj Mahal. J'avais longuement arpenté la ville, et cela me semblait alors évident que je n'y reviendrai plus. Je n'arrivais plus à arrêter de pleurer, c'était somme toute exagéré.
Quand j'ai repris mes esprits, consciente que j'étais tout de même dans l'un des plus beaux monuments du monde, j'ai commencé à visiter ce que je pouvais. J'ai déambulé dans les jardins, les musées, et les merveilles qui s'y trouvaient ne cessaient de me faire imaginer ce que j'étais en train de manquer.
J'étais dans un état second, reconnaissant mais sonné, qui m'a laissé songeuse.
Je pensais à cet élan, cette curiosité qui m'anime, ce besoin irrépressible de liberté et de découverte, à m'en mettre plein les mirettes, qui m'enjoint à voyager, seule la plupart du temps. Je m'en voulais tellement d'avoir mal prévu, mal lu, mal compris qu'il s'agissait - et à raison - du monument le plus visité d'Europe. J'y voyais comme un entrechoc entre ma façon de vivre, mobile, changeante, improvisée, et ce grand déferlement de consommation culturelle qui nécessite désormais une planification des mois à l'avance. Un instant, je me suis sentie vraiment seule au monde, consciente que je n'arrivais pas vraiment à tout faire: être une femme libre et soignée (cela prend du temps), que mon esprit était, forcément, embrumé par toutes les petites contraintes du voyage féminin: faire attention à sa sécurité, éconduire gentiment le bon monsieur du camping qui fait des avances sous capes, ou la ribambelle d'inconnus qui empêchent si souvent d'avoir le nez en l'air et l'esprit insouciant en découvrant une ville; ne pas prendre mal les tics des serveurs qui aiment rarement réserver une table en terrasse pour une seule personne, sourire quand on se fait parler comme à une imbécile chez le garagiste, répondre aux regards étonnés, partout, tout le temps, voir défiler les questions mentales dans les yeux quand je dis que je voyage en solo.
Ce matin là, dans les jardins de l'Alhambra, c'est comme si toutes ces petites difficultés structurelles s'étaient condensées pour m'exploser à la figure. Immense fatigue.
Cette liberté, en fait, elle a un sacré prix, social, mental, familial, organisationnel. Alors quand un grand rêve d'enfance est contrecarré, c'est un peu tout l'édifice d'une vie choisie qui s'effondre en un instant.
On aurait dit un moment initiatique. Être à Grenade, qui contient toute la longue symbolique de ce fruit fermé renfermant des merveilles, ce matin du jour des morts, à devoir faire une sorte de deuil.
J'ai mis longtemps à reprendre mes esprits et, tant qu'à être là, de m'en mettre plein les yeux avec tout ce que je peux. J'ai regardé toutes les vidéos didactiques, et me suis attardée dans ces endroits souvent désertés des musées, ces sous-sols dédiés aux spécialistes d'architecture, plein de plans et de maquettes compliquées. Quel monument fou.
Et puis il y a eu ce moment précis, au sortir de la dernière exposition, en contrebas du grand bâtiment circulaire central, qui ouvrait sur une petite cour. C'était l'heure du déjeuner, c'était soudainement très calme. Il y avait cette petite barrière de rien du tout empêchant l'entrée au Palais des Nazrides. J'ai regardé autour de moi, personne. Alors je suis passée dessous. Je pensais vite me faire arrêter par un vigile planqué derrière un poste de vidéosurveillance.
Mais non.
Je me suis vite mélangée à la foule, peinant â croire que j'étais dorénavant à l'intérieur, et que ç'avait été au final si facile.
Quelle joie folle de découvrir l'Alhambra dans cet état là, et de laisser la beauté faire son office de guérison. Je me suis prise une immense claque, et un bon petit rappel de la vie. Le lâcher prise ouvre à la magie des possibles. Ce n'est pas quelque chose que l'on décide, mais que l'on doit traverser. Devant la fontaine aux 12 lions qui protègent un subtil miroir d'eau, au centre du palais, je me suis sentie immensément reconnaissante, et magnifiquement accompagnée.
L'Alhambra est si dingue, si profondémment dans le détail que - et je m'étais dit pareil devant les estampes d'Hokusai - ça ne donne pas grand chose en reproduction. C'est le contact direct avec la matière qui produit ce sentiment d'immensité tant recherché. Et cela exolique, ma foi, pourquoi il faut prendre son billet des mois à l'avance pour s'offrir cela. C'est unique, et majestueux.
*
Sierra Nevada - Peñiscola
Après une nuit frisquette et un matin embrumé dans le désert de la Sierra Nevada, puis une bonne journée de route, halte repos improvisée sur la Costa de la Azahar où je suis arrivée tard. Une nuit vraiment assez cauchemardesque, en pleine célébration grouillante, majoritairement allemande et hollandaise, de la nuit d'Halloween, dans un quartier de bord de mer qui sentait la fin de saison et la friture. Tout ce qui monte redescend dit l'adage, c'était vraiment l'exact contraire sensible de ma visite de l'Alhambra, avec ici de gros camping cars reluisants, pléthore de tentes et terrasses en plastique alignés sur de semi-terrains vagues où trainent de bon matin jusqu'à la plage de ventripotents retraités avec toute sorte de petits chiens en laisse.
Belle baignade dans une eau fraîche et cristalline, cela dit, sous une fin d'aube encore rose, et départ.
Un panneau sur l'autoroute: Peñiscola. J'avais complètement oublié cette jolie petite ville si chère à ma maman. Si j'ai déjà abondamment parlé des grands voyages de mon père, me sont ici revenus en mémoire ceux que nous faisions souvent, entre filles, au même moment.
Je ne sais pas comment lui était venu l'idée de venir par ici, dans ce petit bled blanc accroché sur un rocher qui plonge dans la mer. Peut-être via Nonita, une femme avec un large sourire et un fort accent, qu'elle n'osa jamais appeler notre femme de ménage, mais qui venait, chaque semaine, l'aider deux heures à tenir la maison.
Je m'y suis évidemment arrêtée, et c'est avec une vraie curiosité mémorielle que je me suis baladée dans ces jolies ruelles.
Comme partout en Espagne et ailleurs, le centre historique semble avoir été déserté de ses habitants, remplacé par des airbnb, d'abondants bistrots touristiques et échoppes de breloques plus indiennes que catalanes. Mais cela reste fort joli. Soudain, au tournant, un bistrot à l'angle, et un souvenir qui surgit: nous avions tellement ri des "bouélées" (grands cris en vaudois) que poussait la tenancière en appelant sa fille. "Maria Josééé!!!" C'était devenu une ritournelle à rire familiale.
Ce qui me touche aujourd'hui, dans ce voyage que je fais à peu près au même âge qu'elle auparavant, c'est qu'il en fallait aussi du courage pour remplir une petite voiture (une AX minuscule, Citroën forcément) et filer seule en Espagne avec ses gamines. Il n'y avait pas de GPS, de téléphones portables, ni les codes sociaux d'aujourd'hui il y a près de 40 ans.
Je me souviens qu'en préparant l'exposition "Faire route", j'avais retrouvé des télégrammes de mon père réclamant des nouvelles depuis l'Inde, le Vietnam, la Thaïlande. Alors je l'ai imaginée, dans la petite poste du coin, à prendre le temps de lui transmettre l'essentiel comme elle le faisait souvent sur de petits billets sur la table de la cuisine: "On est à Peñiscola, fait chaud, tout va bien, love."
Ma mère aussi était une femme d'une force redoutable, dont j'ai hérité le besoin de "foutre le camp" (comme elle disait). Ses voyages étaient certes moins grandiloquents, mais pendant les fameux barouds paternels, elle se lançait dans des virées espagnoles, en ramenait quantité de poteries et paniers dont on ne savait plus que faire, s'y achetait des espadrilles à talons qu'elle portait, très chic, avec des pantalons blancs. Elle racontait souvent que, petite, elle se "trissait" (mot vaudois pour dire qu'on s'échappe de façon filoute) par la fenêtre de chez ses parents, et que son père, lui lançait parfois par la fenêtre de sévères "le bon dieu te punira!", ce qui ne semble toutefois pas s'être réalisé.
Jolie halte, donc, et d'excellentes sèches à la plancha, avant une longue route entrecoupée de vent.
*
Barcelone
À 19 ans, j'étais tombée amoureuse de Barcelone. Je travaillais alors dans un club qui produisait les plus folles soirées électroniques de Lausanne, et lorsque la première ligne low cost avais ouvert, Antoine, le boss, avait rempli un avion et organisé une sortie de boîte d'une nuit de clubbing à Barcelone. Pour l'époque c'était complètement fou, et j'en avais profité pour arpenter la ville dans tous les sens. Quelques semaines plus tard, j'y retournais, comme chaque année pendant longtemps, durant la Mercè.
C'était touchant, donc, de retrouver Barcelone près de 20 ans plus tard. La ville a changé, son centre, dévasté par le tourisme de masse dont j'ai ma foi fait partie, a largement perdu son âme vénéneuse et mystérieuse, mais reste d'une grande beauté traversée de lumière.
"On a changé aussi" avons-nous pouffé avec le musicien et performeur Mila Von Chobiak, en commandant deux thés un soir sur une terrasse de la Plaça Reial. Nous nous étions connus lors de nuits mémorables d'antan, jamais revus, et nous sommes longuement racontés nos parcours respectifs.
J'ai pris l'une des rares et dernières petites auberges dans son jus tenue par une grand-mère, à deux pas de la triangulaire place Orwell, qui se transforme toujours en cours des miracles au petit matin, et me suis émue de voir les Ramblas vides alors que je me rendais à l'aube travailler chez Ady, producteur solaire et infatigable qui parcours le monde en montant des studios d'enregistrements, qui a eu la bonté de me prêter son nid sur les toits pour que j'y travaille tranquillement mes montages.
Parce que je m'étais surtout arrêtée à Barcelone pour une rencontre calée avec le génial producteur et musicien Raül Refree à propos du magnifique livre qu'il vient de sortir (en espagnol pour l'instant) sur le processus de création. Cette entretien fleuve réalisé dans le petit jardin de la librairie La Central paraît bientôt.
Une dernière belle soirée de cinéma à Poble Nou avant de continuer ma remontée en écoutant le dernier album de Rosalia sorti ce jour-là.
*
Figueras & Port Lligat
Lors de mes études en histoire de l'art, je m'étais inscrite à un cours sur Salvador Dalí, pour voir. Je ne connaissais alors de lui - comme la plupart - que ses montres molles ou autres éléphants hauts perchés. Ça ne me touchait pas vraiment, mais j'étais curieuse. Peu à peu, j'ai découvert l'ampleur de son travail, et derrière sa figure de farfelu, la puissance d'une vaste pensée. J'ai fini par en faire mon sujet de licence...
Je les connaissais bien pour les avoir étudiés de loin, mais fauchée et prise entre plusieurs boulots pour financer mes études, je n'avais pas eu l'occasion à l'époque de me rendre à Figueras pour voir son théâtre-musée labyrinthique, ni à Port Lligat près de Cadaquès pour visiter sa maison, qui sont pourtant deux pièces maîtresses de son oeuvre-totale de vie, inspirée par celle de Wagner, qu'il écoutait de façon quasi rituelle.
J'ai donc été ravie de réouvrir cette boîte de Pandore là.
Pour Dalí, la folie n’était pas un vertige incontrôlé, mais un outil pour explorer les profondeurs de l’esprit. Il y avait sous ses excès une pensée d’une grande finesse, attentive aux mécanismes de l’inconscient et aux mouvements secrets du désir. On le sait peu, mais il fut un véritable expérimentateur de l’âme humaine, très proche de Lacan et des idées naissantes de la psychanalyse. Il cherchait à rendre visible la logique irrationnelle, à utiliser les mécanismes de la psychose comme moteurs d’intuition artistique.
Ses livres "La Vie secrète de Salvador Dalí", "Journal d’un génie" et d'autres essais théoriques sont d'une écriture ciselée, tout bonnement géniale, et cherchent à comprendre les forces qui sculptent la mémoire et la perception. Il était obsédé par le fonctionnement de l’esprit, par les métamorphoses du temps et de l’identité.
Et puis, il y a son incroyable histoire avec Gala, femme-axe vertical, muse, compagne, gardienne, et, plus qu'un grand amour - comme l'ont si souvent fait les épouses des grands hommes de l'Histoire - elle était un point d'ancrage dans ce grand chaos qui permis d'engendrer ce qui en reste aujourd'hui.
J'adorais le " Portrait de Gala portant deux côtelettes en équilibre sur son épaule" et, à le découvrir étonnamment si minuscule (tout au plus un quart de carte-postale) dans son gros cadre doré, que l'ai trouvé d'autant plus touchant.
Dalí n’a cessé de brouiller les frontières, entre rêve et réalité, déconnade et prestige, folie et clairvoyance, et c’est dans cet entrelacs qu’il reste vraiment hypnotisant.
Une belle halte, donc, entremêlée du bal des étourneaux sur des couchers de soleils d'un rose poudré.
Atelier Studer-Ganz (2017)
sous le mentorat d'Antoine Jaccoud & Eugène
Haut, bas, fragile
Ce n’est pas comme si cela se voyait facilement, mais il y avait en lui cette chose qui penche comme un poids décalé dans la cale d’un bateau. La vieille l’avait repéré car elle connaissait bien les hommes. Elle les avait vus passer sur leurs tracteurs devant sa maison, puis au guichet de la poste du village, aujourd’hui fermé. Perçu cette fausse nonchalance au sein même de son foyer, où cette légère crispation de mâchoire précédait toujours les grands débordements. La tristesse, ça vous colle au corps, d’autant plus si on tente de la cacher.
Lui laissait entendre qu’il avait évité le pire, trouvé la bonne parade en mettant toute son énergie dans cette nouvelle maison. Il se croyait sorti d’affaire, et ne repérait pas vraiment ses propres patterns, ces mouvements répétitifs qui, dans ce qu’ils ont d’imperceptiblement rigides, prouvent qu’on a perdu de vue la confiance dans le joyeux chaos des choses. Le matin, été comme hiver, il prenait son café devant la maison, en tirant sur une cigarette qu’il pouvait pourtant, dorénavant, fumer à l’intérieur. Perpétuer les vieilles habitudes, comme pour conjurer le sort, sans quoi il n’était tout bonnement pas supportable. Son couloir était resté jonché de boîtes, où il avait entassé sa vie. Il les déplaçait, modifiait savamment les piles, libérait l’entrée d’un air amusé lorsqu’on passait le voir, à se frotter l’arrière de la tête, à chercher des yeux l’espace qui pourtant était là tout autour. Elles restèrent là longtemps, comme les briques d’un quotidien qu’il ne parvenait pas à reconstruire. Il mis des mois à investir le premier étage, répétant à tout va qu’il fallait d’abord changer la moquette des chambres, mais trouvant secrètement un étrange réconfort dans le fait de dormir sur un lit de camp dans le petit réduit décrépi du rez-de-chaussée. Tout, désormais, de haut en bas, ne pouvait qu’être fragile.
*
Mon Oncle
Je le retrouve parfois dans les mains noueuses de mon cousin, qui ressemblent à celles de mon père, avec ces phalanges élargies qu’on attribue d’ordinaire aux artisans. Mon oncle était un intellectuel, de ceux qui pensent trop pour être supportables. On l’appelait « Tonton Macoute », ou plutôt, c’était le sobriquet qu’il s’était choisi, car il s’était toujours su quelque peu terroriste, père fouettard en puissance, bonhomme-bâton.
Gamin, on l’avait dit caractériel, et un peu vite placé dans un internat de montagne, où il se languissait de son grand frère, qu’il ne cessât pourtant jamais de tourmenter. Puis, il avait rencontré Florence, une fort belle femme, fille de pêcheur devenue maître d’Ikebana, qui, un temps, le sauva du naufrage. Elle lui donna deux beaux enfants, un garçon et une fille, et ils vécurent quelques années, les plus heureuses sans doute, dans un immense appartement au sol rêche, en fibre de coco, avec une baignoire ronde dans la salle de bain et une cheminée dans la chambre. Il était de ces grand-reporters qui écrivent bien, mais étouffent leurs récits de leurs trop plein de velléités d’écrivain. Il parcourait le monde, l’Asie surtout, noircissant des carnets d’où il extirpait probablement toutes ses lettres tendres mais acides, qu’on recevait avec appréhension. L’alcool eu raison de son mariage. Tant, qu’une ordonnance restrictive fut établie pour protéger Florence et les enfants. Il partit en Thaïlande un moment, ce qui soulagea tout le monde, avant de revenir plumé, craignant dorénavant - c’était signé - les mafias locales. On l’installa dans le vieux chalet familial de Barboleusaz, qu’il décora de panne de velours, bouddhas, et autres tenka, avant de le vendre discrètement à un riche étranger qui le démonta.
Il descendit vivre en plaine, dans un petit trois-pièces mansardé, non loin d’un bistrot à poivrots dont il finit par faire partie, et n’y remonta plus que pour noircir un blog que l’on s’efforça de ne pas trop consulter. A Noël, on ne pouvait s’empêcher de « penser à Jean-Louis », sans pour autant plus trouver la force de l’inviter. Ce n’était pas faute d’avoir essayé, mais on avait retenu la leçon des tentatives du passé. En reprenant contact, nous remuions une vase, dynamitions son marécage hanté par un esprit solitaire, lui l’exclu, le damné, l’insupportable. Alors on essayait de l’aimer de loin.
On savait bien qu’il resterait là, à Bex, au social, jusqu’au jour de sa mort, qui survint en janvier, vingt-cinq ans après sa mère, cinq après son père, deux après son frère. On trouva l’appartement dans un état qu’on ne soupçonnait pas, mais, au fond d’un tiroir, dans une fourre en plastique renfermant tous ses papiers, un mot, aussi, manuscrit de sa part : « je n’ai pas de dettes ».
*
La marche
Je ne suis pas de ceux qui aiment marcher seul, ou alors pas très souvent. Je suis à peu près sûre qu’il doit y avoir quelque chose à y trouver, et il m’est arrivé d’essayer de me forcer pour voir si dans les conseils de quelques grands marcheurs solitaires que j’aime, comme Rousseau ou Beauvoir, se cachait la clef du bon développement d’une pensée, ou un quelconque mode d’emploi pour écrire. Mais non, en fin de compte, cela ne m’inspire pas vraiment. Seule, c’est à l’arrêt, en observation, jamais bien loin de mon point de départ, que je me mets véritablement en marche.
Mes rares balades en solo dans la nature ne sont tout au plus qu’un recours, une sorte de médicament pour faciliter le transit d’une émotion, celui de la colère surtout, que l’on peut effectivement laver, d’une certaine façon, dans la dépense d’énergie et au contact de la végétation. Aller d’un point à un autre pour éviter les transports en commun ou écouter de la musique en mouvement, oui, mais de longues balades de plaisance, je n’en fais pas souvent.
En revanche, j’adore voir marcher les gens, et il n’est pas rare que j’éreinte ceux auprès de qui j’aime déambuler. Je crois que la façon dont nous marchons en dit plus sur quiconque que tout autre chose. Et marcher auprès de quelqu’un résume parfaitement la relation entretenue, elle aussi mouvante. En somme, ça marche, ça ne marche pas, ou plus.
Il existe ces personnes solaires, qui viennent à vous en gambadant, dont la légèreté dit beaucoup de l’ingénuité avec laquelle ils arpentent la vie. Rien n’est plus beau que lorsqu’une fluidité s’installe entre deux personnes dans l’espace. Et rares sont ceux contre lesquels on ne se cogne jamais. Marcher à leur côté est comme une danse, un truc qui groove, vraiment musical.
Il y a quelques années, je suis tombée amoureuse d’un garçon dont la démarche ne cessait de me surprendre. Au début, je me retrouvais souvent comme plantée d’un côté de la rue alors qu’il avait traversé sur un coup de tête, ou ne s’était pas arrêté au passage clouté en même temps que moi. Différente perception du danger, quelque chose de frondeur. Il marchait souvent devant, et j’aimais voir ses épaules légèrement remontées, et aussi son pas un peu saccadé, sans souplesse dans les hanches, qui lui donnait ce quelque chose de très viril. Tout le temps, même sur de courtes distances, un petit rien, imperceptible pour moi, l’arrêtait net : un objet dans une vitrine, le chant d’un oiseau, une babiole au sol. C’était alors une joie de revenir sur mes pas et découvrir la raison de cette cassure de rythme soudain, de partager cette autre façon de voir le monde. A la maison, il se déplaçait sans bruit. J’entr’apercevais souvent sa silhouette dans l’encadrure des portes, constatait ses allées et venues, nombreuses par intermittences. Vitesse et lenteur, c’est toujours selon, et c’est l’éventail de cette multiplicité en lui que je ne cesse d’aimer. Les mauvais jours, il a les pieds vaguement en dedans, d’ailleurs, ses semelles sont plus usées vers l’intérieur, symétriquement. Il ne possède qu’une paire de chaussures, dont il ne se sépare que lorsqu’elles ne sont vraiment plus mettables, après avoir racheté exactement les mêmes. Au jour le jour, il ne prend pas le soin d’en faire ou défaire les lacets, car, dans cette nonchalance, comme dans la vie, il est toujours prêt à partir à l’aventure, se contente du minimum nécessaire, et ne s’embarrasse pas de problèmes pratiques inutiles. J’aime constater le chemin parcouru, combien nous avons appris à marcher ensemble, côte à côte. Les reflets dans les vitres ne me renvoient plus seulement deux personnes bien distinctes, ce que nous restons pourtant, mais aussi une entité compacte en déplacement. Je ne compte plus les nuits où nous avons traversé la
ville, et j’avoue avoir eu un pincement au cœur lorsqu’il a commencé à rechigner devant les distances à parcourir, ou à ne me proposer que le même tour dans le parc d’à côté. Irrémédiablement, cela a signifié pour moi la fin d’un quelque chose, qui s’épuise toujours avant de vraiment s’en aller, et qu’il ne sert à rien de retenir.
Ces temps, je marche beaucoup avec Fred. Depuis peu, il fait de tous petits pas, ne lève plus beaucoup les genoux et ne déroule plus du tout les pieds. Nos ballades s’accompagnent désormais du petit son sec et maladroit de ses mocassins sur le macadam. Il avance très lentement, tant et si bien qu’il devient compliqué de marcher à ses côtés, de lui prendre le bras sans craindre de le brusquer. Ainsi, il va falloir s’y faire, lui aussi, tout autrement, s’en va gentiment.
*
Les jolies choses
3 juillet
Adrien en bas de la rue, avec ses sacs, devant, derrière, et son sourire de grand gamin qui s’en va.
5 juillet
Le brouhaha de la discothèque qui entre par la fenêtre de la cuisine, déserte, à une heure du matin.
11 juillet
Au réveil, recevoir la photo d’un paysage, envoyé pendant la nuit.
12 juillet
Le petit corps de Diane dans une grosse embrassade de départ de vacances en Grèce.
13 juillet
Virée sur le campus. Pas un chat, et l’impression de marcher sur une maquette.
16 juillet
La grande Joëlle et son étrange beauté aristocratique qui arrivent en vélo sur la terrasse du restaurant vietnamien.
17 juillet
Au volant, ce mélange d’infinie tristesse et de grand soulagement, le coffre plein de mes affaires.
25 juillet
Me réveiller tôt et dans les arbres, au bruit d’un affluent du Rhin.
29 juillet
Quand il a dit « t’es encore là, toi ! », juste avant d’éteindre.
1er août
Un jour comme la veille d’un départ, un jour papillon.
3 août
Le combo « Chuck Berry, chorizo, Orangina » sur le toit de Stéphane, qui, au sortir de la douche, traîne à remettre un t-shirt pour exhiber son beau corps – il est vrai - de 56 ans.
5 août
Chez un fleuriste arménien, choisir un immense Lys Casablanca. Et ensuite, son odeur merveilleuse dans l’appartement.